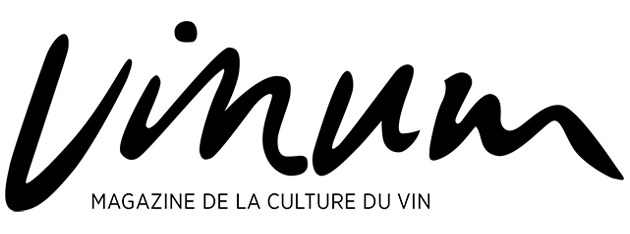Tradition
Le grand mythe vigneron
Texte: Alexandre Truffer
Des sommets de Visperterminen aux vallées venteuses du littoral chilien, la quasi-totalité des vignerons se revendiquent de la tradition. Mais quels sont les faits derrière ce terme fourre-tout du marketing viticole? Que ce soit à la vigne ou en cave, les pratiques actuelles n’ont rien de commun avec celles de l’époque romaine ou du Moyen-Âge, ni même avec celles des grands-parents des vignerons d’aujourd’hui.
En dix ans passés à arpenter les vignobles de Suisse et d’ailleurs, j’ai souvent eu l’impression d’assister à un concours généralisé de «qui a la plus longue»? Je parle de tradition évidemment. «Deux millénaires ininterrompus», vous annonce fièrement le vigneron d’Europe occidentale, tandis que le producteur crétois vous conduit sur les ruines du pressoir de Vathy petro, vieux de 3600 ans. Et face aux domaines du Golan ou de la Bekaa qui revendiquent des origines bibliques, les Géorgiens exhibent des kvevris de 8000 ans. A ce moment de la conversation, un représentant du «Nouveau Monde »vient rappeler la faiblesse de ces vantardises puisque ces histoires plurimillénaires concernent la vigne domestique, un végétal disparu des continents européen, africain et asiatique à la fin du 19e siècle. L’affaire se corse encore lorsque chacun vous explique en aparté qu’il est à la pointe de la (r)évolution qualitative qui caractérise sa région depuis quelques années. En résumé, pour s’inscrire dans la tradition millénaire, il semble qu’il faille faire l’inverse de papa et de grand-papa.
Au service d’une chimère
A la base du vin, il y a la vigne et à la base de la vigne, il y a une chimère. En génétique, ce terme désigne un organisme formé de deux (ou plus) populations de cellules génétiquement disctinctes à l’image de la vigne moderne composée d’un porte-greffe, issu d’une vigne américaine résistante au phylloxéra, et d’un cépage européen, doté de qualités organoleptiques intéressantes. L’histoire commence au 16e siècle lorsque les colons de la côte est de l’Amérique du nord se mettent à faire du vin. Le nouveau continent abrite des vignes indigènes, mais celles-ci donnent naissance à des vins au goût douteux. Ils décident donc de planter des variétés amenées d’Europe, qui périssent systématiquement après quelques vendanges. Cette mortalité est due à un petit insecte parasite, le phylloxéra. Au fil du temps, les trajets en bateau entre l’Europe et l’Amérique deviennent plus rapides. Au début des années 1860, leur durée s’avère suffisamment courte pour permettre à cet hémiptère de survivre au voyage vers l’Europe. En 1863, il détruit des vignes à Roquemaure, dans le Gard. A la fin de la Première Guerre Mondiale, il a atteint la Mandchourie, l’Afrique du Sud et le Maghreb, ravageant tous les vignobles traversés dans l’intervalle. Précisons qu’il ne s’agit pas ici de dégâts partiels comme pour la Suzukii, l’es ça ou les attaques des mildiou et d’oïdium, mais d’une destruction totale des parcelles touchées. A l’heure actuelle, seul le Chili (protégé par son éloignement, le désert d’Atacama et les Andes) ainsi que quelques parchets disséminés dans des régions peu accessibles (à l’image de Visperterminen en Valais) ou très sablonneuses (le sable empêche l’insecte de creuser des galeries entre les plants) cultivent encore de la Vitis vinifera traditionnelle et non une chimère.
Problèmes de libre-circulation

Le phylloxéra n’est pas le seul ravageur de la vigne à avoir pris le bateau pour l’Europe. Les champignons à l’origine de l’oïdium (1845), du mildiou (1878) et du black rot (1885) ont tous fait le même voyage. L’apparition de ces maladies cryptogamiques de la vigne a bien entendu forcé les vignerons à s’adapter en aspergeant de fongicides leurs vignes. La Revue Agricole de juin 1897 indique que: «pour les vignes très sujettes à l’oïdium, [...] un premier traitement avant les effeuilles est de rigueur. Puis, [...] un ou plusieurs soufrages au moment opportun, suivant la marche de la maladie. » Le journaliste de cet hebdomadaire vaudois aurait été sans doute surpris de savoir qu’un peu plus d’un siècle plus tard, le nombre de traitements avait pris l’ascenseur. Une étude de 2010 du Ministère français de l’agriculture indiquait que chaque parcelle de vigne avait reçu en moyenne 16 traitements phytosanitaires dont 12 de fongicides, 2 d’insecticides et2 d’herbicides. Ce document fait état de diversités importantes puisque la moyenne régionale monte à 20 en Champagne et descend à11 en Provence. Et ce n’est pas la tendance bio ou biodynamique qui va inverser cette évolution à la hausse du nombre de traitements puisque les produits autorisés en bio sont en général des substances de contact, qui ne pénètrent pas dans la plante, sont lessivés en cas de pluie et doivent donc être plus souvent administrés en cas de météo capricieuse.
La ronde des cépages
Columelle agronome romain On peut considérer que la tradition, défi nie comme un ensemble de coutumes et d’usages transmis depuis des générations, doit nécessairement intégrer des évolutions causées par des événements imprévus et brutaux tels que l’arrivée inattendue d’espèces invasives. Néanmoins, la majorité des changements dans la vigne est décidée par les vignerons pour des motifs économiques ou pratiques. Connue depuis l’Antiquité, la culture en hautains, ou hutins, consiste à utiliser les arbres comme tuteurs de la vigne. Elle permet de pratiquer la polyculture, lorsque les arbres concernés sont fruitiers, et, vu que les vignes se développent en hauteur, laisse la possibilité aux petits animaux d’élevage de pâturer sans s’attaquer aux jeunes pousses. A Lavaux par exemple, des actes de vente du 14e mentionnent «des vignes avec les arbres qui sont à l’intérieur de celles-ci». Toutefois, à partir de 1560 se développe la fabrication d’échalas, des pieux de bois secs utilisés comme tuteurs. Les arbres disparaissent alors du paysage tandis que la vigne devient une monoculture qui permet une cvb0 densification des plantations et donc une augmentation des récoltes.
«Le vin de la meilleure qualité
est celui qui peut se conserver
longtemps sans avoir besoin
de condiments, et qu’il n’y faut
mettre aucune mixtion»Columelle agronome romain
On entend parfois que la sélection de cépages et l’achat de plants chez des pépiniéristes est l’une des conséquences du phylloxéra. En fait, la production de barbues, ces jeunes plants prêts à être plantés, est beaucoup plus ancienne. On trouve dès le début du19e siècle des annonces dans les Gazettes de Lausanne et Genève pour: «de belles barbues des espèces de vignes ci-après: de fendant vert de Lavaux, de fendant roux, de fendant gris, de rouge de la Dôle, de rouge Cortaillod, de Salvagnin, de rouge d’Orléans, de Meunier rouge très-hâtif, de Moreillon rouge le plus hâtif, de Ruchelin blanc, de Tokai, de Malvoisie, de Madère, de Chasselas rose, de dit de Fontainebleau, de dit musqué, de Muscat rouge et blanc, de plant du Rhin, de raisin tricolore et de rouge en naissant, de Teinturier...» Cette publicité qui date d’avril 1830 montre que le vignoble vaudois ne se composait pas que de Chasselas. Toutes les régions helvétiques ont connu la même évolution. Ainsi, le Merlot, cépage phare du Tessin (85% du vignoble), n’a été introduit dans le canton qu’en 1906. Même constat en ce qui concerne la superficie des vignobles: en 1901, la Suisse comptait 30 112 hectares de vignes, et les plus importants cantons viticoles étaient: Vaud (6618 hectares), Tessin(6562 hectares), Zurich (4769 hectares), Valais(2605 hectares), Argovie (2080 hectares),Genève (1813 hectares) et Neuchâtel (1177 hectares).En 2015, les 14 792 du vignoble suisse se répartissaient bien différemment: Valais 4906, Vaud 3771, Genève 1410, Tessin 1097. Quant à Zurich et à Argovie, il n’abritent plus que 606et 384 hectares de vignes.
Investir pour maintenir

Si la vigne apparaît moins inerte que ce que l’on s’imagine, la vinification est elle aussi en constante métamorphose. Certains propagandistes du «naturel» diffusent allègrement un discours postulant que les additifs ne sont utilisés dans le vin que depuis un demi-siècle. Ils laissent entendre qu’avant, le vin se faisait tout seul, patiemment et presque sans intervention humaine. En fait, il n’en est rien. Les vins dit «nature» sont un pur produit de la viticulture du 21e siècle qui nécessite un équipement et des connaissances très poussées ainsi qu’une maîtrise absolue de la chaîne du froid. L’ajout de substances – plus ou moins efficaces et plus ou moins toxiques – dans le vin pour le stabiliser remonte sans doute aux premiers vignerons. De fait, la plus grande partie de la littérature relative à la vinification se compose de recettes pour soigner le vin. Abstinthe, fenugrec, poix, eau salée, racine d’iris ou plomb font partie de la centaine d’ingrédients recensés chez les auteurs latins pour «réparer» le vin, car comme le précise Columelle «le vin de la meilleure qualité est celui qui peut se conserver longtemps sans avoir besoin de condiments, et qu’il n’y faut mettre aucune mixtion qui altérerait sa saveur naturelle». Avec le temps, les additifs évoluent, mais la créativité des (al)chimistes connaît peu de limites. Ainsi «l’auteur œnologue» L.-F. Dubief écrit en 1834 un Manuel qui explique comment faire une imitation d’un vin de Bourgogne, de Bordeaux ou du Roussillon à partir de n’importe quel moût. En réalité, la définition moderne du vin comme un «produit exclusif de la fermentation alcoolique de raisin ou de moût de raisin» date de la loi (française) Griffe de 1889 adoptée pour juguler les tensions sociales causées par la concurrence des vins artificiels (mélange de raisins secs importés d’orient, alcool, eau et sucre). Une publicité valaisanne de 1910 laisse entendre que les vins artificiels n’ont pas disparu de sitôt puisque Albert Margot qui proposait à la vente des fournitures pour faire soi-même du vin de raisins secs (16 francs pour 200 litres) explique que 600 000 litres de cette boisson ont été bus en 1909... De fait, la démonstration pourrait se poursuivre dans tous les aspects du métier de vigneron ou de caviste. Elle indique que ces métiers ne consistent pas à répéter des gestes millénaires mais plutôt à constamment trouver des solutions pour répondre aux défis posés par les évolutions ou les caprices de la nature, de l’économie et des hommes.